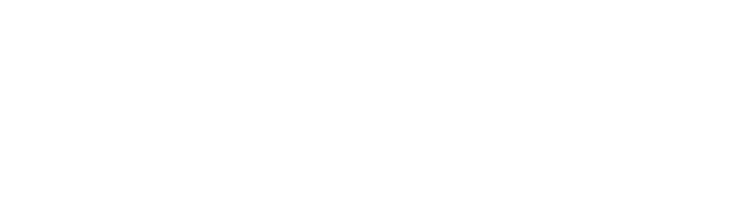Le Séminaire de Lacan de 1975-1976, intitulé Le Sinthome[1], est entièrement consacré à James Joyce, écrivain irlandais du XXe siècle. Dans ce Séminaire, Lacan affirme à plusieurs reprises que ce qui a amené Joyce à son désir d’être un artiste, à produire son art, c’est la démission paternelle. Au sein de son œuvre, Joyce a essayé de remédier à la carence paternelle en ne cessant de faire vivre sa propre relation à son père. Joyce croit à l’indignité de son père, il y reste enraciné, et c’est ce qui en fait son symptôme. Citons Lacan : « Joyce a un symptôme qui part de ceci que son père était carent, radicalement carent – il ne parle que de ça. J’ai centré la chose autour du nom propre, et j’ai pensé – faites-en ce que vous voulez, de cette pensée – que c’est de se vouloir un nom que Joyce a fait la compensation de la carence paternelle. »[2] Dans son cours « Pièces détachées », Jacques-Alain Miller précise que « Joyce […] s’est senti appelé à autre chose qu’à s’identifier comme les autres. [Il] s’est employé à valoriser son nom, son nom propre, mais aux dépens du père, c’est-à-dire à se valoriser dans sa singularité »[3].
La singularité de Joyce réside dans son écriture et plus précisément dans la façon dont il a déconstruit le langage, a fait bruisser d’échos la langue, révélant ainsi que derrière l’ordre langagier, il y a la jouissance pure de la lettre. Quand on se plonge dans son œuvre, on se rend compte que le sens en vient de plus en plus à s’amoindrir. Cette réduction commence dès Ulysse[4] et elle atteint son apogée dans Finnegans Wake[5]. Ce qui compte pour Joyce, c’est la sonorité de la langue et non pas le sens. Joyce disait que si quelqu’un ne le comprenait pas, il n’avait qu’à le lire tout haut. Il espérait d’ailleurs que les universitaires l’étudient pendant plus de trois cents ans. L’écriture a donc permis à Joyce de se libérer du parasite parolier et de se laisser envahir par la polyphonie de la parole. L’écriture constitue ainsi la voie royale vers le réel. La liberté que Joyce rencontre vis-à-vis de la parole fait dire à Lacan que Joyce est « désabonné à l’inconscient »[6]. Le sinthome joycien est en effet pour Lacan ce qu’il y a de plus individuel chez cet écrivain, à tel point qu’il n’accroche rien de notre inconscient, qu’il soit si difficile de le lire, et que la seule chose que l’on puisse attraper, c’est sa jouissance. Son sinthome est ainsi son nom propre, soit ce qu’il y a de plus singulier chez lui, ou comme le dit Lacan, ce qui lui permet de s’identifier à l’individual[7]. Néologisme qui résume la structure de LOM[8] pour Lacan, à savoir le singulier de la jouissance de chaque Un-dividu[9].
Le Séminaire Le Sinthome demeure une boussole indispensable pour l’analyste d’aujourd’hui, que ce soit dans sa praxis, mais aussi dans sa lecture de notre époque régie par l’évaporation du père. L’écriture, par l’intermédiaire de l’équivoque, permet d’atteindre la jouissance Une de chaque corps parlant, de passer de l’inconscient transférentiel à l’inconscient réel. « Joyce le symptôme »[10] est aussi paradigmatique de l’individu moderne qui, confronté à cette pulvérisation du père, essaie de valoriser son nom, sa singularité. L’homme du XXIe siècle croit dur comme fer au déclin du patriarcat, il ne parle que de ça. Ceci explique la pluralisation des noms et le foisonnement de nouvelles nominations de plus en plus éparses. Multiplication des S1 à défaut de la routine paternelle : S1-S2. La montée des Ego, à laquelle nous assistons au sein de l’individualisme de masse contemporain, serait, si l’on suit là encore Joyce, la suppléance moderne généralisée. À l’image de Joyce, ce Séminaire XXIII, nous n’avons pas fini de l’étudier, de nous en servir.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005.
[2] Ibid., p. 94.
[3] Cf. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Pièces détachées », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 9 février 2005, inédit.
[4] Joyce J., Ulysse, Paris, Gallimard, 2013.
[5] Joyce J., Finnegans Wake, Paris, Gallimard, 1997.
[6] Lacan J., « Joyce le symptôme », Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op.cit., p. 164.
[7] Ibid., p. 168.
[8] Lacan J., « Joyce Le Symptôme », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 565.
[9] Cf. Lacan., Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2011, quatrième de couverture.
[10] Lacan J., « Joyce le symptôme », Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op.cit., p. 161-169.
Image : © Fred Treffel